XVIIIe siècle
-

« Editorial » ; « Avis au lecteur » – Amis et ennemis de Jean-Jacques Rousseau du XVIIIe siècle à aujourd’hui – Deuxième partie : Cultures politiques de J.-J. Rousseau – C. MAZAURIC, « Le Rousseau de Maximilien Robespierre » ; P. KNEE, « Maistre critique de Rousseau » ; C. CASSINA, « Rousseau Bonald : un regard sur l’état de la question » ; B. INNOCENTI, « Diffusion, prévention et traitement de l’ "épidémie de la philosophie plaisante" dans l’Italie de la fin du XVIIIe siècle » – Discussion – A. LANZA, « Le bon Jean-Jacques et le penseur d’un autre siècle : les Rousseau de la république démocratique et sociale » ; G. GENTILE, « La réception du Contrat social dans la pensée politique méridionale » ; A. MARCHILI, « De la fondation à la crise de la démocratie : Rousseau et Les Origines de la France contemporaine de Taine » – Discussion – H. ROSSI, « Rousseau et Chateaubriand : Chateaubriand juge de François-René » ; C. THOMAS-RIPAULT, « Les encombrantes Confessions de J.-J. Rousseau : modèles et contre-modèles de l’autobiographie romantique après 1830 » ; T. TON-THAT, « Anna de Noailles, lectrice et admiratrice de Rousseau : variations poétiques autour d’un mythe littéraire et d’un lieu de mémoire » – Discussion – C. MATOSSIAN, « L’esprit orné encore de quelques fleurs : Rousseau dans le réseau d’amis de Michelet » ; S. LABRUSSE « Baudelaire contre Rousseau » ; F. JAKOB, « Une guerre non sans haine : Nietzsche et le cas Rousseau » – Discussion – Troisième partie : Rousseau défiguré ? – P. MARTIN-HORIE, « Jules Lemaître ou le mauvais quart d’heure de J.-J. Rousseau » ; A. ZLATOPOLSKAIA, « De Fonzivine à Tolstoï et à Dostoïevski : amis et ennemis russes de Rousseau » – Discussion – T. ROBERT, « L’anthropologie rousseauiste et l’origine du langage : critiques herderiennes et condillaciennes » ; N. J. MARTIN, « L’image de Rousseau musicien au cours des siècles » – Discussion – Quatrième partie : Aujourd’hui Rousseau – P. PELLERIN, « Ernest Seillière, un contempteur acharné de Rousseau » ; V. PONZETTO, « Victor-Donatien de Musset-Pathay, éditeur et défenseur de Rousseau » – Discussion – I. RAMOS, « Rousseauistes, amis ou ennemis ? » ; A. POLLIEN, « La réception sociologique de Rousseau : la faute à Durkheim ? » ; L. VIGLIENO, « Jean-Jacques Rousseau sur le divan de René Laforgue, pionner de la psychanalyse en France » – Discussion.
-
-
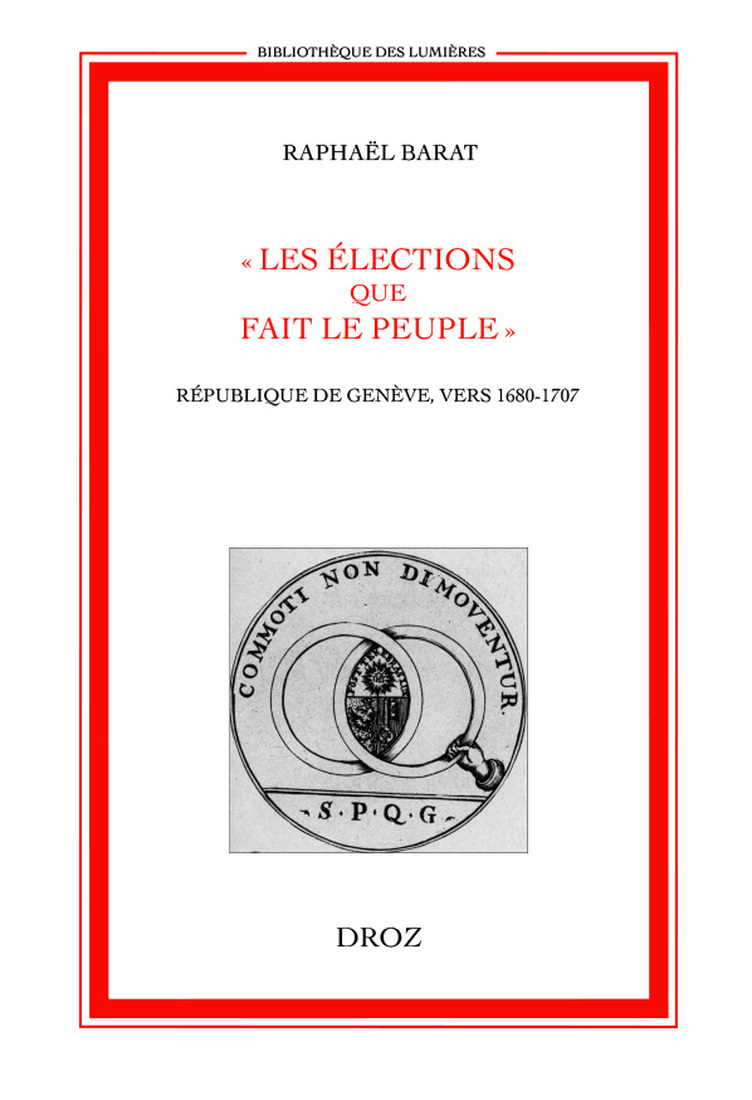
Au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, alors que des régimes patriciens ont triomphé dans la plupart des républiques européennes, la République de Genève reste une démocratie de jure, où la souveraineté appartient au Conseil général, assemblée de tous les bourgeois et citoyens. Néanmoins, cette souveraineté théorique survit seulement dans des élections que l’historiographie a souvent réduites à des simulacres, la République étant aristocratique de facto. Comment comprendre alors ce qui se passe quand il ne se passe rien, et raconter l’histoire de ces élections « que fait le peuple » ? Raphaël Barat met d'une part à jour les ressorts de la domination aristocratique dans ces élections populaires, de la théorie politique à l'organisation même de l'espace de vote le jour de l'élection, en passant par l’analyse des carrières politiques des magistrats. Il montre d'autre part avec sagacité que des grains de sable se glissent parfois dans les rouages, que les électeurs se départissent dans certaines circonstances de leur déférence habituelle, et que des tensions apparaissent quand ces derniers ne sont plus sûrs de pouvoir honorer le serment qu'on leur fait prêter d'élire « ceux qui sont idoines ». Le cas de la République de Genève permet ainsi de mieux comprendre les enjeux et les pratiques du vote d'Ancien Régime, nouveau terrain d'enquête pour les historiens de la période moderne.
-

Sommaire/Contents: F. DUVAL, "Conflit d'interprétations : typologie des facteurs de choix éditoriaux"; G. DECLERCQ, "La mise en livre des archives du haut moyen âge : le cas du second liber traditionum de l'abbaye de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin (milieu du xr• siècle)"; N. LAURENT-BONNE, "Notes sur deux canonistes méridionaux du XIVe siècle: Guillaume de Rosières et Aymeric de Montal"; A. BRUX, "Une réécriture méconnue des Grandes Chroniques de France: signalement, tradition manuscrite, sources"; É. FAISANT, "François Gabriel et les du Cerceau : la correspondance inédite d'un architecte provincial à la fin du XVIe siècle"; M. STOLL, "« Ils étaient comme de petits dieux ... » : les conseillers au Conseil royal des finances,
1661-1715"; M. FRIEDRICH, "Les feudistes-experts des archives au XVIIIe siècle : recherche des documents, généalogie et savoir-faire archivistique dans la France rurale" - Mélanges - P. BOURGAIN, "A la recherche des caractères propres aux manuscrits d'auteur médiévaux latins"; G. PASTORE et F. DUVAL, "La tradition française de l'Infortiat et le Livre de jostice et de plet"; M. CASSAN, "Engagement et appartenances: les vies des magistrats Étienne de Lestang (1510-1581) et Antoine de Lestang (1541-1617)"; J. DELMULLE, "Un mécèné en disgrâce: l'épître dédicatoire retrouvée de la Bibiotheca Coisliniana (1715)"; R. ALLEN, "Un nouvel acte de Guillaume le Bâtard, duc de Normandie (18 juin 1066)"; P.-V. CLAVERIE, "Les origines génoises de la famille Carròs"; B. HERENCIA, "Éphémérides du citoyen et Nouvelles éphémèrides économiques : vicissitudes éditoriales et signatures" - Bibliographie - Chronique - Résumés - Table alphabétique.
Sommaire/Contents: F. DUVAL, "Conflit d'interprétations : typologie des facteurs de choix éditoriaux"; G. DECLERCQ, "La mise en livre des archives du haut moyen âge : le cas du second liber traditionum de l'abbaye de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin (milieu du xr• siècle)"; N. LAURENT-BONNE, "Notes sur deux canonistes méridionaux du XIVe siècle: Guillaume de Rosières et Aymeric de Montal"; A. BRUX, "Une réécriture méconnue des Grandes Chroniques de France: signalement, tradition manuscrite, sources"; É. FAISANT, "François Gabriel et les du Cerceau : la correspondance inédite d'un architecte provincial à la fin du XVIe siècle"; M. STOLL, "« Ils étaient comme de petits dieux ... » : les conseillers au Conseil royal des finances,
1661-1715"; M. FRIEDRICH, "Les feudistes-experts des archives au XVIIIe siècle : recherche des documents, généalogie et savoir-faire archivistique dans la France rurale" - Mélanges - P. BOURGAIN, "A la recherche des caractères propres aux manuscrits d'auteur médiévaux latins"; G. PASTORE et F. DUVAL, "La tradition française de l'Infortiat et le Livre de jostice et de plet"; M. CASSAN, "Engagement et appartenances: les vies des magistrats Étienne de Lestang (1510-1581) et Antoine de Lestang (1541-1617)"; J. DELMULLE, "Un mécèné en disgrâce: l'épître dédicatoire retrouvée de la Bibiotheca Coisliniana (1715)"; R. ALLEN, "Un nouvel acte de Guillaume le Bâtard, duc de Normandie (18 juin 1066)"; P.-V. CLAVERIE, "Les origines génoises de la famille Carròs"; B. HERENCIA, "Éphémérides du citoyen et Nouvelles éphémèrides économiques : vicissitudes éditoriales et signatures" - Bibliographie - Chronique - Résumés - Table alphabétique.
-
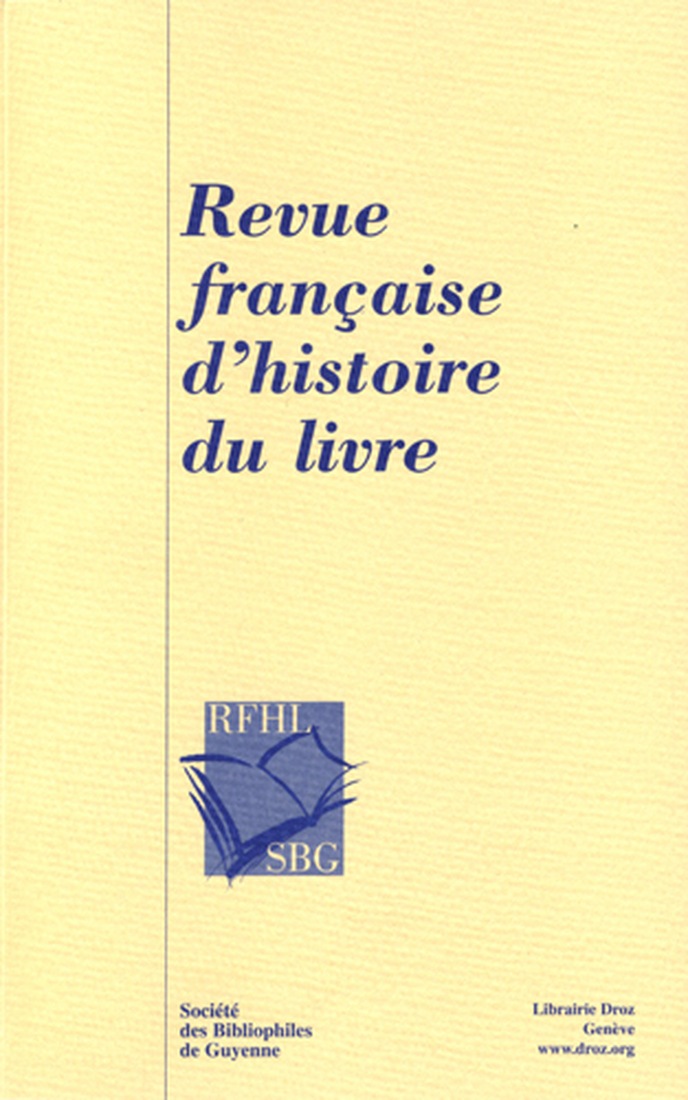
Sommaire
I. Etudes - Samuel GRAS, "L'atelier de Jean Poyer à Madrid. Un missel au temps des fiançailles de Charles VIII et Marguerite d'Autriche"; Annalisa MASTELOTTO, "Au fil des pages: les notes marginales de l'exemplaire de travail de la Bibliotheca Universalis de Gesner consacrées aux auteurs italiens"; Evelien CHAYES, "Bibliothèques bordelaises à l'époque de Montaigne"; Dominique VIDAL, "Le Théâtre d'Agriculture et mesnage des champs, d'Olivier de Serres dans les catalogues de ventes de bibliothèques au XVIIIe siècle, de Jacques-Auguste de Thou à Jean-Baptiste Huzard"; Peter NAHON, "Un regard bordelais sur le rite comtadin en 1847, assorti de quelques notes sur la disparition de celui-ci"; Michel WIEDEMANN et Pierre COUDROY DE LILLE, "Les hommes illustres de Plutarque à nos jours: à propos d'une collection de François Séraphin Delpech"; Christophe BLANQUIE,: "L'érudit, l'évêque et le ministre: le premier Tamizey de Larroque"; Xavier ROSAN, "L'écrivain Louis Emié (1900-1967) et les arts"; Nathalie DIETSCHY, "Le livre d'artiste: au-delà de la page à l'ère digitale" - II. Variétés - André GALLET, "Corisande, Henri de Navarre et Montaigne"; Gilles DUVAL; "Registre de sommet et Cartes de visite, des imprimés parfois négligés: l'exemple du Pic Long (3.192 m), 1928-1939".
-

Table of contents / Table des matières : I. Foreward / Avant-propos – II. Lire Le neveu de Rameau – D, BREWER, « The Nephew’s Time : Temporality and the Moment in Diderot’s Le neveu de Rameau » ; A. WALL, « Diderot’s chronophotographic writing in Rameau’s Nephew » ; J.-C. BOURDIN, « Jean-François Rameau contre-philosophe » ; J.-L. MARTINE, « L’art et la matière : aperçus sur l’écriture du matérialisme dans Le neveu de Rameau » ; F. BOULERIE, « “Mes pensées, ce sont mes catins” : ambiguïtés et compromission de la philosophie dans Le neveu de Rameau » ; J.-P. CLÉRO, « Commerce, pesées et calculs dans Le neveu de Rameau » ; Z. HAKIM, « Des bénéfices de la déraison : subversion et libération dans Le neveu de Rameau de Diderot » ; P. CASINI, « Le neveu de Rameau ou les sables mouvants de la dialectique » ; P. DUC, M. HOBSON, « Le neveu de Rameau : Eighteenth-Century Music as a Stepping Stone to Hegelian Dialectic » ; B. SAINT-GIRONS, « Y a-t-il un sublime dans le mal ? “Un brigand heureux avec des brigands opulents” » ; C. KLETTKE, « Le génie sublime et sa parodie : deux mises en scène de Diderot » ; L. NOUIS, « La colère et la joie : éthique et esthétique des passions dans Le neveu de Rameau » ; J.-A. PERRAS, « Usages et réformes : Le neveu de Rameau et les ambivalences de l'originalité » ; M, DELON, « Le neveu de Rameau et la jolie femme » ; K. E. TUNSTALL, « Le neveu de Rameau, règne des magots et des pagodes » ; J. LEICHMAN, « Quantum Performance : Intersubjectivity, Uncertainty, and The neveu de Rameau » ; P. VON HELD, « Insights with Hindsight : Adapting Le neveu de Rameau for the Citizens Theatre, Glasgow, 1998 367 » ; K. BARTHA-KOVáCS, « Le neveu de Rameau au miroir de sa réception hongroise : de l’interprétation philologique à une approche » ; S. ZENGINE, « L'expansion de la Mimésis : Le neveu de Rameau et une légende biographique d’André Chénier ».
Table of contents / Table des matières : I. Foreward / Avant-propos – II. Lire Le neveu de Rameau – D, BREWER, « The Nephew’s Time : Temporality and the Moment in Diderot’s Le neveu de Rameau » ; A. WALL, « Diderot’s chronophotographic writing in Rameau’s Nephew » ; J.-C. BOURDIN, « Jean-François Rameau contre-philosophe » ; J.-L. MARTINE, « L’art et la matière : aperçus sur l’écriture du matérialisme dans Le neveu de Rameau » ; F. BOULERIE, « “Mes pensées, ce sont mes catins” : ambiguïtés et compromission de la philosophie dans Le neveu de Rameau » ; J.-P. CLÉRO, « Commerce, pesées et calculs dans Le neveu de Rameau » ; Z. HAKIM, « Des bénéfices de la déraison : subversion et libération dans Le neveu de Rameau de Diderot » ; P. CASINI, « Le neveu de Rameau ou les sables mouvants de la dialectique » ; P. DUC, M. HOBSON, « Le neveu de Rameau : Eighteenth-Century Music as a Stepping Stone to Hegelian Dialectic » ; B. SAINT-GIRONS, « Y a-t-il un sublime dans le mal ? “Un brigand heureux avec des brigands opulents” » ; C. KLETTKE, « Le génie sublime et sa parodie : deux mises en scène de Diderot » ; L. NOUIS, « La colère et la joie : éthique et esthétique des passions dans Le neveu de Rameau » ; J.-A. PERRAS, « Usages et réformes : Le neveu de Rameau et les ambivalences de l'originalité » ; M, DELON, « Le neveu de Rameau et la jolie femme » ; K. E. TUNSTALL, « Le neveu de Rameau, règne des magots et des pagodes » ; J. LEICHMAN, « Quantum Performance : Intersubjectivity, Uncertainty, and The neveu de Rameau » ; P. VON HELD, « Insights with Hindsight : Adapting Le neveu de Rameau for the Citizens Theatre, Glasgow, 1998 » ; K. BARTHA-KOVáCS, « Le neveu de Rameau au miroir de sa réception hongroise : de l’interprétation philologique à une approche satyrique » ; S. ZENGINE, « L'expansion de la Mimésis : Le neveu de Rameau et une légende biographique d’André Chénier ».
-

Le Dictionnaire des gens de couleur, dans son troisième et dernier volume, achève de révolutionner une vision qui aurait fait de l’immigration issue des colonies, noire ou métisse, un phénomène purement contemporain. Les estimations initiales ont même été réévaluées, à la faveur des investigations poussées dans le midi, pour porter à près de 20 000 le nombre des nouveau-venus dans la France d’ancien régime. Registres de passagers et fonds des amirautés, mais aussi registres paroissiaux et états nominatifs à l’heure où la Monarchie a voulu éloigner « Noirs, mulâtres et autres gens de couleur » du territoire, ont permis d’appréhender ces hommes et ces femmes, tantôt libres serviteurs ou esclaves à talent dans les ports. Bien sûr, Bordeaux devenue à la veille de la Révolution le premier port français a joué un rôle majeur dans ces entrées, à peine moins nombreuses qu’à Nantes. Mais La Rochelle précocement engagée dans la voie du Nouveau Monde et Marseille tentée à la fin du XVIIIe siècle par une conversion de son commerce du Levant en direction de l’Atlantique ont aussi participé à une immigration qui s’est accrue avec la perte, en 1763, du premier empire colonial. De là, c’est tout un monde de petites gens, en retrait des ports où les mascarons des hôtels particuliers ont rendu écho à leur condition, qui a trouvé sa place dans ces arrière-pays dont les moindres bourgades, languedociennes ou provençales, ont révélé des unions mixtes, et parfois même donné naissance dans l’ombre des plus grandes familles – Mirabeau ou Guizot – à des branches métisses.
-

L’histoire de la famille Necker est celle d’une ascension sociale unique. Jacques Necker (1732-1804), d’origine bourgeoise modeste, débute comme banquier à Paris, fait fortune avec la Compagnie des Indes et, en 1776, devient Ministre des Finances de Louis XVI et achète le château de Coppet en 1784. Sa fille Germaine (1766-1817), mariée à Eric Magnus de Staël-Holstein, est la seule héritière de cette fortune. Au cours de sa courte vie (elle meurt à l’âge de 51 ans), Germaine de Staël publie une trentaine de livres et d’essais, dont les deux plus connus sont Corinne ou l’Italie (1807) et De l’Allemagne (1810). Elle tient son titre de gloire d’être une exilée et farouche opposante à Napoléon. Quand elle ne voyage pas, elle reste à Coppet où elle est aussi connue pour avoir rassemblé autour d’elle « les Etats généraux de l’opinion européenne ». Elle a su tisser des réseaux d’amitiés à travers toute l’Europe et les Etats-Unis. Ce travail prend comme point de départ ce réseau d’intellectuels et d'aristocrates polyglottes pour mieux comprendre les différentes facettes et mécanismes de la sociabilité au château de Coppet. Martina Priebe étudie le lien subtil entre le Groupe de Coppet comme mouvement intellectuel et le rayonnement de Coppet comme mécanisme de communication, avec l’organisation de la vie quotidienne (jeu, fête, dîner) et l’espace du château (les chambres, le mobilier et les œuvres d’art). Elle montre que la sociabilité à Coppet, entre Lumières et romantisme, a été un terrain fécond pour imaginer avant de les propager maintes idées républicaines.
-
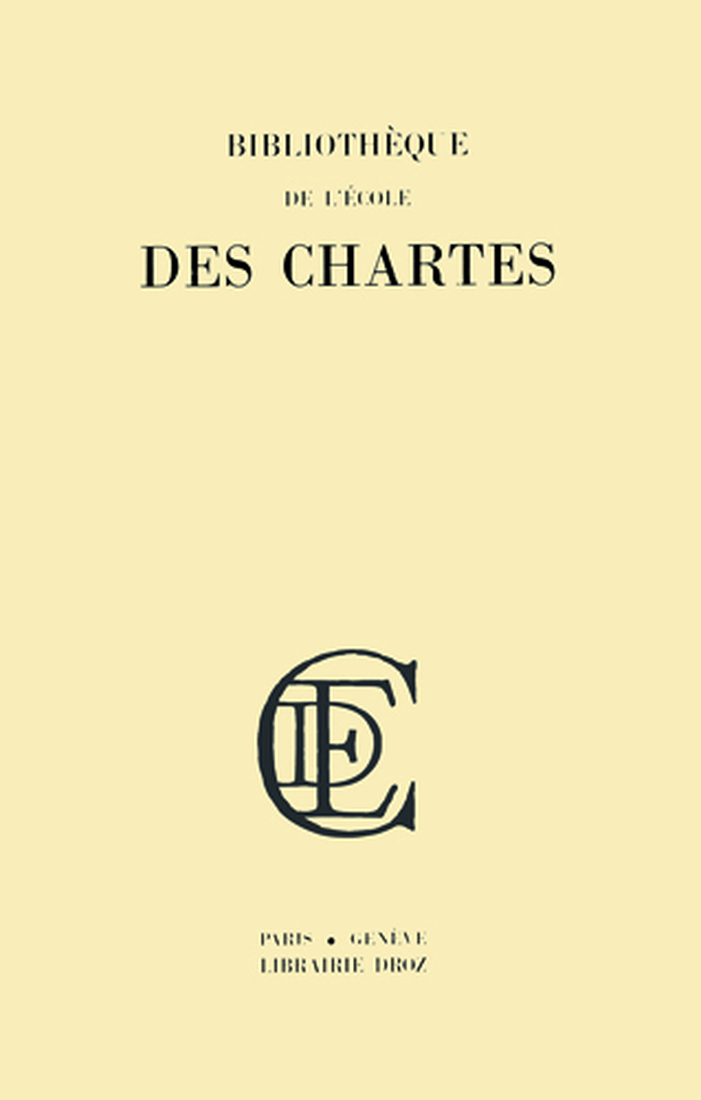
Sommaire: E. Chapron, J. Boutier, « Utiliser, archiver, éditer. Usages savants de la correspondance en Europe, xviie-xviiie siècles »; M. Greengrass, L. Penman, « L’ombre des archives dans les cultures du savoir du xviie siècle : les papiers de Samuel Hartlib (v. 1600-1662) »; J. Boutier, A. Bruschi, « Dans les ‘‘armoires’’ de Baluze : constitution, organisation et pratiques des archives épistolaires d’un savant au Grand Siècle »; M. Stuber, « Les archives épistolaires d’Albrecht von Haller : Formation, perception, réception d’une correspondance »; A. Saada, « La pratique de la correspondance de Christian Gottlob Heyne (1763-1812) : annoter, administrer, archiver »; P. Bret, « La correspondance de Lavoisier : pratiques matérielles de la lettre dans un corpus savant des Lumières » - Mélanges - P. Bourgain, « À la recherche des caractères propres aux manuscrits d’auteur médiévaux latins »; G. Pastore, F. Duval, « La tradition française de l’Infortiat le Livre de jostice et de plet »; M. Cassan, « Engagement et appartenances : les vies des magistrats Étienne de Lestang (1510-1581) et Antoine de Lestang (1541-1617) »; J. Delmulle, « Un mécène en disgrâce : l’épître dédicatoire retrouvée de la Bibliotheca Coisliniana (1715) » - Bibliographie - Comptes rendus critiques - Notes de lecture - Résumés.
Sommaire: E. Chapron, J. Boutier, « Utiliser, archiver, éditer. Usages savants de la correspondance en Europe, xviie-xviiie siècles »; M. Greengrass, L. Penman, « L’ombre des archives dans les cultures du savoir du xviie siècle : les papiers de Samuel Hartlib (v. 1600-1662) »; J. Boutier, A. Bruschi, « Dans les ‘‘armoires’’ de Baluze : constitution, organisation et pratiques des archives épistolaires d’un savant au Grand Siècle »; M. Stuber, « Les archives épistolaires d’Albrecht von Haller : Formation, perception, réception d’une correspondance »; A. Saada, « La pratique de la correspondance de Christian Gottlob Heyne (1763-1812) : annoter, administrer, archiver »; P. Bret, « La correspondance de Lavoisier : pratiques matérielles de la lettre dans un corpus savant des Lumières » - Mélanges - P. Bourgain, « À la recherche des caractères propres aux manuscrits d’auteur médiévaux latins »; G. Pastore, F. Duval, « La tradition française de l’Infortiat le Livre de jostice et de plet »; M. Cassan, « Engagement et appartenances : les vies des magistrats Étienne de Lestang (1510-1581) et Antoine de Lestang (1541-1617) »; J. Delmulle, « Un mécène en disgrâce : l’épître dédicatoire retrouvée de la Bibliotheca Coisliniana (1715) » - Bibliographie - Comptes rendus critiques - Notes de lecture - Résumés.
-
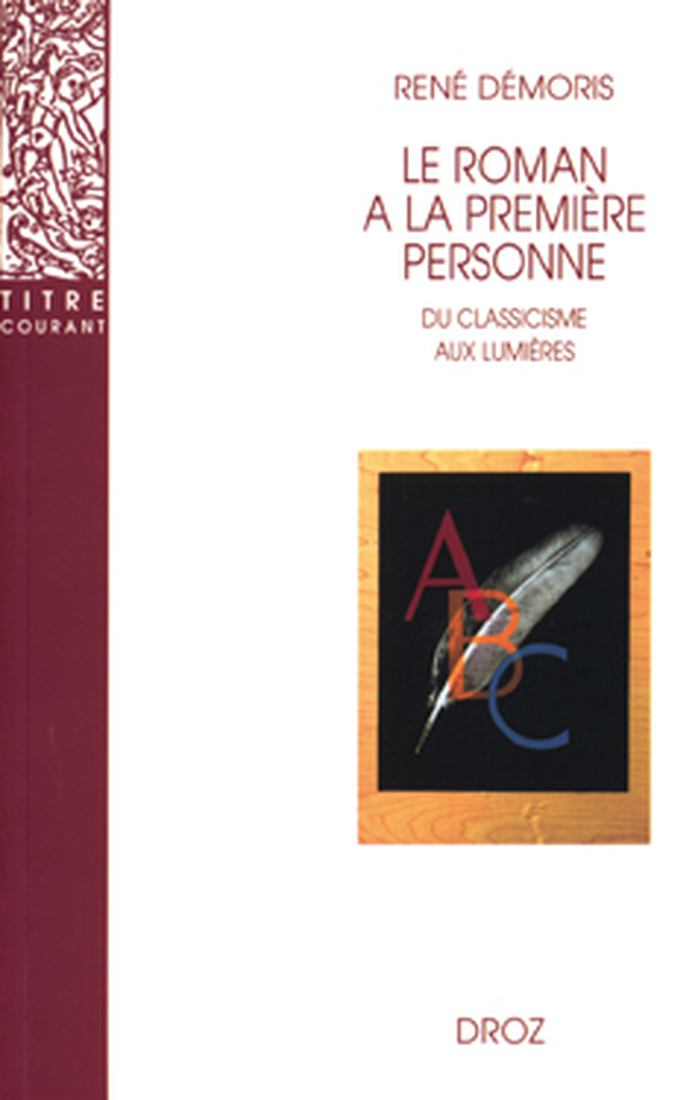
Au Siècle des Lumières, le héros de roman prend la plume. Saisi d’une rage de raconter sa vie et de se donner une histoire, il devient un écrivant. René Démoris explore une forme romanesque liée, au début du XVIIe siècle, au roman picaresque espagnol et qui prend son essor dans les mémoires authentiques et fictifs de l’époque classique. Elle triomphe dans l’autobiographie pittoresque – et à nouveau picaresque – de Gil Blas de Santillane, avant de s’épanouir chez Marivaux et Prévost. Démoris définit le rapport qu’entretient ce roman à la première personne avec la mutation sociale, culturelle et politique qui va produire ce monstre singulier, l’individu, et qui mène au sacre de l’écrivain. Fiction singulière que celle où s’exerce la première personne, laquelle suggère à ses lecteurs un exercice de critique autant que d’identification. En attendant qu’avec Jean-Jacques et ses Confessions, roman-mémoires enfin vrais, l’auteur jette le masque. L’exaltation du Je narratif renvoie au fondement même de notre relation à la littérature. A-t-on une autre histoire que celle qu’on s’invente et qu’on écrit ?